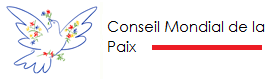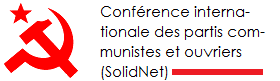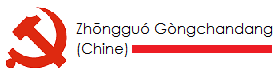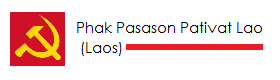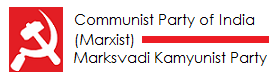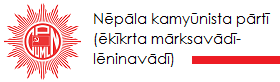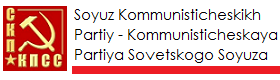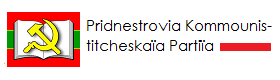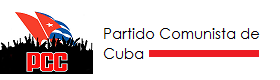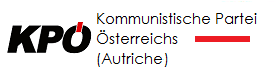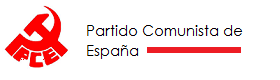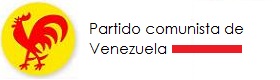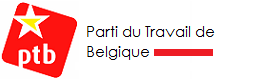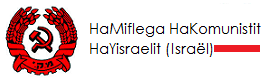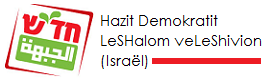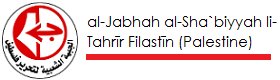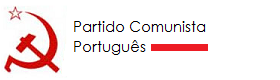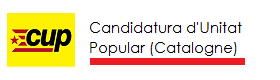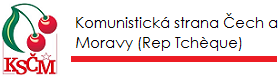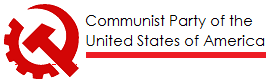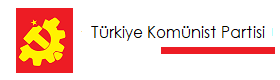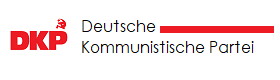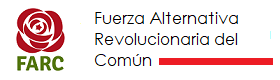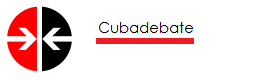C’est son côté Che Guevara, hasta siempre, toujours sur la brèche. Le médecin argentin révolutionnaire jusqu’au martyre, sa bonne étoile à lui, la première des ombres tutélaires que l’on débusque vite, tant elle colle sur toutes les parois de son existence : dans son local syndical à l’usine, sur les vitres de son coupé, dans son appartement. Pas d’icône aseptisée ici et, quand dans la taule où la moyenne d’âge ne dépasse pas les trente-cinq ans, les très nombreux jeunes l’appellent le « Che », Pierre Le Ménahès s’efforce de mériter l’hommage, au-delà du cliché. Intenable, insatiable, il aime l’intégrité de ce « Christ rouge » qui « abandonne son intérêt pour se consacrer aux autres ». Sa devise l’illustre encore : « Je peux démissionner de mes mandats, mais pas de mes idées. » Et quand la victoire s’annonce à la SBFM, le syndicaliste lance devant la foule rassemblée à la cantine, avec l’accent reconnaissable entre tous : « On a demandé l’impossible, et on l’a obtenu ! » Mais à présent, à peine un mois plus tard, il ronge déjà son frein : « C’est un autre lien avec la référence du Che : tu mènes un combat, tu l’as gagné, OK, bravo ! Mais c’est quand le prochain ? Renault va nous reprendre, mais tout n’est pas joué. »
Pour Pierre Le Ménahès, cinquante ans, la lutte ne doit jamais s’arrêter, comme une liesse permanente, une fête de famille dans laquelle il incarne tantôt le fils, tantôt le frère, tantôt le père. L’affaire d’un clan turbulent, élargi, recomposé qui s’embrasse et qui s’engueule. À l’origine, il y a naturellement ses propres parents, un routier et une coiffeuse, pas militants du tout : « Ils ne m’ont pas transmis la fibre, c’est venu plus tard, mais quelques valeurs tout de même. Mon père ne supportait pas l’injustice sociale. » Puis, une petite poignée de frères d’armes, des vrais, croisés pendant son service militaire chez les paras à dix-sept ans et demi : « Cela paraît ironique avec le recul, constate-t-il. Mais quand on est face à des ordres débiles, on fraternise intuitivement. Et dans l’océan Indien, lorsque, entre le port et la caserne, on nous balançait des galets parce qu’on portait l’uniforme de la puissance coloniale, on comprend vite : c’est la misère, l’exploitation et le racisme qui dominent, et nous, on est censés protéger ce système-là… »
Ensuite, en 1979, c’est par l’entremise d’un oncle de son ex-femme, agent de maîtrise à la fonderie, qu’il rentre à la SBFM. « Ça s’est joué sur un coin de table, raconte-t-il. J’avais un petit boulot de magasinier et on me promettait 1 500 balles de plus par mois. » Le parent par alliance l’incite à adhérer à la CGT - un passage presque obligé à la SBFM, où le syndicat est déjà en situation de quasi-monopole -, mais c’est pour mieux le prier de se tenir à carreau. « Je ne connaissais rien à l’usine, se souvient Pierre. Mais voilà, je me retrouve devant une chaîne Rotocop, très célèbre à l’époque parce qu’on se tuait à la tâche dessus. C’était très pénible, répétitif, les Temps modernes, quoi. On m’avait vanté le bon salaire, mais dans de telles conditions de travail, cette somme-là, ce n’était rien du tout. »
Après une rencontre décisive avec un prêtre-ouvrier qui, dans les ateliers, « savait écouter et mettre des mots sur ce qu’on ressentait », le jeune homme adhère à la CGT. « Je me suis jeté dans les actions, les débrayages… Cela m’a valu une fâcherie énorme dans la famille. Pendant dix ans, je n’étais jamais invité et, quand c’était inévitable pour les très grandes occasions, on me plaçait à l’extrémité de la table… » Avec Roger Prado, son mentor cégétiste et communiste à la SBFM, un des piliers ouvriers de l’usine depuis sa création, en 1966, sur les cendres des forges d’Hennebont, Pierre Le Ménahès apprend vite. Il hérite, il s’approprie et, aujourd’hui, il transmet à son tour à des jeunes qui, souvent rescapés des bagnes de l’agroalimentaire dans les environs, sont d’autant plus intransigeants dans la défense des acquis gagnés à la SBFM. Puis, au milieu des années 1990, les deux hommes se brouillent sur une « futilité », et c’est Pierre qui quitte le syndicat pendant trois ans, un si long exil forcé. « On était très entiers tous les deux, forcément ça faisait des étincelles », déplore-t-il. Puis soudain, cette brume dans le regard : il y a deux ans, ce second père est mort, avant que l’un et l’autre ne réussissent à recoller les morceaux. La plaie demeure, encore ouverte, inguérissable, au fond, tout comme la fièvre de la lutte.
Le 26 juin dernier, en pleine euphorie de la victoire à la SBFM, Pierre Le Ménahès dédie le moment à Roger Prado. En plan large, 600 bonshommes qui se donnent l’accolade, et en plan serré, une embrassade qui en vaut mille autres : le beau-frère de son ex-mentor, lui aussi à la fonderie, vient l’étreindre, alors qu’ils ne se parlaient plus depuis dix ans. Au syndicat - près de 400 « cartes » sur 550 salariés -, la relève est assurée. Et Pierrot le Che continue de disperser, selon les consignes de son héros disparu en Bolivie, les braises rougeoyantes de la révolte : « Une, deux, trois, mille SBFM ! » Intranquille, il dort mal. Satanées étoiles qui brillent trop fort.
Des goûts et des couleurs
- Un héros, une héroïne de fiction ? Je n’aime pas la fiction.
- Votre meilleur souvenir de la lutte ? La nuit de la victoire, le 26 juin, quand on s’est retrouvés à une centaine en bleu de travail au PMU d’Hennebont. Fiers d’être en ville et de boire un coup tous ensemble.
- Un pays où vous aimeriez vivre ? Cuba, pour la résistance permanente, la joie de vivre, la convivialité et l’absence de résignation.
- Un disque à écouter ? Pour les textes, j’aime Bernard Lavilliers, puis Léo Ferré : « À l’école de la poésie, on n’apprend pas, on se bat. »
- L’état présent de votre esprit ? Dans ma tête, la lutte des classes n’a jamais été autant d’actualité.
- Un mouvement social qui fait encore rêver ? 1936 !