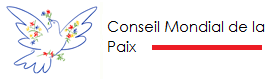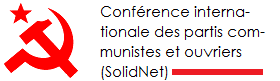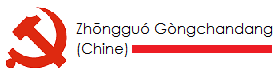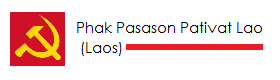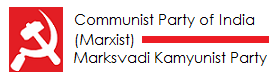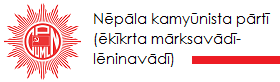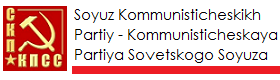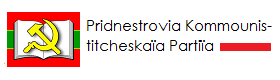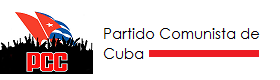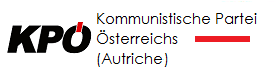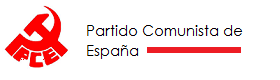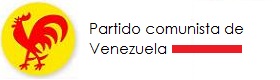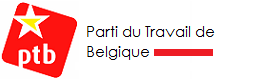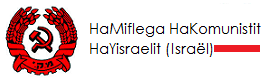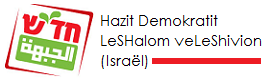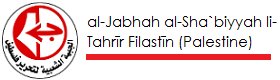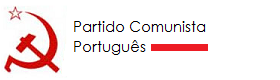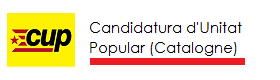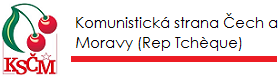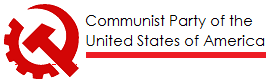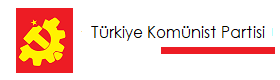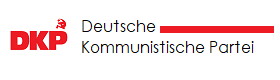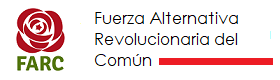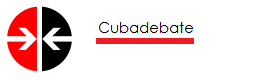Depuis la Libération, le paysage syndical avait quand même bougé…
Il y avait eu en 1947 la scission de Force ouvrière. Ensuite, c’est surtout à la CFTC que les choses ont évolué avec la naissance de la CFDT, sous l’impulsion de militants que je connaissais bien, issus de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) et de l’action catholique ouvrière (ACO). Ils avaient une conception du syndicalisme qui nous rapprochait, au point que nous avions signé en 1966 un accord d’unité d’action.
Quelles étaient, à la veille de Mai 68, vos relations avec Eugène Descamps, alors secrétaire général de la CFDT ?
Je tiens à lui rendre hommage parce qu’au-delà des divergences que nous pouvions avoir, il a toujours privilégié l’unité d’action, le «tous ensemble». Nos relations étaient très suivies, et nous nous tenions mutuellement informés. Ainsi, à la fin des négociations de Grenelle, j’apprends qu’il se prépare une manifestation réunissant la gauche non-communiste, la CFDT, la FEN et les groupes gauchistes. Je vais le voir et il me répond : c’est exact, mais la CFDT n’y participera pas. Cela a donné le meeting du stade Charléty, où la CGT et son secrétaire général se sont fait huer sur le thème : «Négociation, trahison !» La CFDT n’y est pas allée, et les socialistes non plus d’ailleurs, Pierre Mendès France s’y étant rendu au tout dernier moment.
Et avec les étudiants ?
Avec l’Unef, nous avons longtemps été assez proches, en particulier lors des mobilisations contre les guerres d’Algérie puis du Vietnam. Ça s’est compliqué après une crise interne qui a vu le vice-président, Jacques Sauvageot, prendre la tête de l’organisation étudiante.
En fait, vos relations étaient bonnes avec les étudiants communistes !
Bien sûr. Mais au-delà, on était dans un contexte où les jeunes, les étudiants comme les jeunes travailleurs, posaient des questions de société auxquelles partis et syndicats ne répondaient pas toujours. Hasard du calendrier, nous avions organisé plusieurs mois à l’avance une grande rencontre des jeunes de la CGT qui devait se tenir le 17 mai à Pantin.
Aviez-vous vu, dans l’occupation de l’université de Nanterre et la création du mouvement du 22 mars, un signe avant-coureur d’une révolte étudiante ?
Je ne m’en suis aperçu que huit ou dix jours plus tard, avec la très forte médiatisation de Daniel Cohn-Bendit. A l’époque, on m’avait interrogé sur lui et le mouvement des étudiants de Nanterre. J’avais répondu : «Je suis tenté de dire : Cohn-Bendit, qui est-ce ?» Les relations avec ceux que l’on appelait les gauchistes étaient tendues. Il y avait parmi eux des anarchistes, des trotskistes, des maoïstes, des situationnistes, qui n’étaient bien souvent d’accord que sur un point : l’anticommunisme et l’anticégétisme. On se faisait régulièrement traiter de crapules staliniennes et de traîtres à la classe ouvrière. C’est vrai que désigner Daniel Cohn-Bendit comme un «anarchiste allemand», comme l’avait fait Georges Marchais dans l’Humanité, n’était pas mieux. En fait, cette question de la place des groupes gauchistes dans le mouvement étudiant était le principal point de divergence que j’avais avec Eugène Descamps et la CFDT.
Quand avez-vous compris que le mouvement allait prendre de l’ampleur ?
Il y a d’abord eu la manifestation du 1er mai. Depuis 1954, on nous interdisait de manifester à Paris. Cette fois, nous n’avons pas demandé l’autorisation mais simplement informé la préfecture de police de l’itinéraire, en précisant que nous assurerions nous-mêmes le service d’ordre et qu’il serait bien que les forces de police ne se montrent pas sur le passage du cortège. J’avais proposé à Eugène Descamps que la CFDT se joigne à nous. Mais il trouvait que ce n’était pas à la hauteur des enjeux. Le défilé a rassemblé 100 000 personnes, ce qui était la preuve que la température avait monté de plusieurs degrés. Nous le sentions, mais curieusement les politiques ne semblaient pas le voir. Pas plus les communistes que les socialistes.
Le 2 mai, le doyen de Nanterre ferme l’université. Le 3, la Sorbonne est occupée. Les enseignants du Snesup lancent un mot d’ordre de grève pour le lundi 6. Quand la CGT décide-t-elle d’y aller?
A partir du 6 mai, les incidents deviennent chaque soir un peu plus violents. Comme beaucoup de Français, j’écoutais en direct sur Europe 1 le récit des affrontements entre étudiants et policiers. Je me disais que cela allait mal finir. Il n’était plus question de trotskistes, de maoïstes ou de situationnistes, mais de jeunes et de répression policière. Le 9 et le 10 mai ont lieu les affrontements les plus violents, notamment rue Gay-Lussac. Le 10, j’appelle Eugène Descamps, Jacques Sauvageot et le secrétaire général de la FEN pour que nous retrouvions le samedi 11 à 9 heures à la Bourse du Travail. Je leur propose d’avancer au lundi 13 mai la manifestation que nous avions envisagée. Descamps consulte le bureau confédéral de la CFDT et me rappelle à 11 heures pour me dire : c’est d’accord. La FEN et l’Unef font de même.
Aviez-vous le feu vert de l’équipe dirigeante de la CGT pour lancer l’appel à la manifestation du 13 mai ?
J’avoue que la décision a été prise à trois ou quatre. Benoît Frachon était au Japon et Henri Krasucki en RDA. La manifestation a rassemblé entre 800 000 et 1 million de personnes. C’était énorme. J’ai déclaré à l’époque que la force tranquille de la classe ouvrière venait de changer la situation. Le gouvernement, Pompidou et même De Gaulle ont compris qu’ils ne mettraient pas fin au mouvement par la force.
Et côté Parti communiste?
Le 15, deux jours après la manifestation, je participe à une réunion du bureau politique, dont j’étais membre. Je leur dis que l’on est parti pour une grève générale illimitée. Dans des usines comme Sud Aviation à Bouguenais, près de Nantes, ou Renault Cléon, les ouvriers avaient décidé de poursuivre la grève avec occupation. J’ai regardé mes dix-huit camarades du bureau politique, j’ai vu que personne ne me croyait, pourtant ils étaient tous venus à la manifestation du 13. J’ai eu le sentiment que depuis le début, mon propre parti n’était pas à la hauteur de la situation. C’était également vrai des socialistes. Le 20, une délégation de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste (FGDS), conduite par François Mitterrand, vient au siège de la CGT. Il y avait alors 8 millions de grévistes dans le pays. «Ne croyez-vous pas qu’en négociant, vous allez permettre au gouvernement de trouver une porte de sortie ?» nous dit Mitterrand. Et il nous demande si on ne pense pas que les 35 % d’augmentation que nous revendiquions du salaire minimum garanti, le Smig, ce n’était pas un peu excessif. Je lui ai répondu : «Nous pensions vous recevoir en tant qu’allié, et nous avons l’impression de parler à un prochain représentant du pouvoir.» Mitterrand, je l’ai compris par la suite, refusait tout accord d’alternance à gauche pour ne pas être redevable de sa victoire au Parti communiste. Je voulais raconter cela dès 1972. Mais avant de publier le Mai de la CGT, j’ai fait lire ce passage à Georges Marchais et à Charles Fiterman. Ils étaient en pleine négociation sur le Programme commun. Ils m’ont dit que j’étais libre d’écrire ce que je voulais, mais que j’allais faire capoter les négociations avec le PS. Alors j’ai retiré ce passage. Je le rends public cette année.
Entre le 16 et le 20 mai, le mouvement de grève gagne l’ensemble du pays…
Le 17 mai, nous avions cette rencontre prévue de longue date avec les jeunes de la CGT à Pantin. C’était un samedi matin. Je leur ai dit : «Pliez vos affaires et cassez-vous. Rentrez dans vos usines et vos ateliers, c’est là que ça se passe. Repartez tout de suite ! Dans quelques heures, il n’y aura plus un train qui roule.» Nous avions aussi ce jour-là une réunion du Comité confédéral national de la CGT, où nous avons eu un débat : fallait-il lancer un appel à la grève générale ? C’est une vieille nostalgie du mouvement syndical, selon laquelle la grève générale pourrait entraîner la chute du capitalisme. Je peux le confirmer, cela ne marche pas. Il y a bien eu grève générale en 1968 et le capitalisme est toujours là ! La position que je défendais était qu’il fallait laisser la base décider. Et à mon grand émerveillement, c’est comme cela que ça a marché. Dans beaucoup de petites entreprises, où il n’y avait parfois pas de syndiqués, les salariés se sont organisés. Ce fut une explosion de liberté d’expression, un exemple de démocratie ouvrière et syndicale. Je dois dire qu’au sein de la CGT, cela suscitait pas mal de réticences.
Le lundi 20 mai, la paralysie est générale. Renault Billancourt est occupé. Comment se sont ouvertes les négociations de Grenelle ?
Le président du CNPF - le Medef de l’époque -, Paul Huvelin, avait demandé à me rencontrer. Je refuse. Je savais qu’il avait rencontré la CFDT et FO. Côté gouvernement, Georges Pompidou nous fait savoir qu’il souhaite ouvrir des négociations. Je lui réponds : dites-le publiquement. Il le fait, et nous nous retrouvons du 25 au 27 mai au ministère du Travail, rue de Grenelle. Il y avait les représentant du CNPF, le Premier ministre Georges Pompidou, et Jacques Chirac, alors secrétaire d’Etat à l’Emploi.
Vous avez obtenu la hausse de 35 % du salaire minimum que vous revendiquiez. Cela a été difficile ?
Bizarrement, non. Nous pensions qu’il y aurait une forte résistance, mais cela a été acquis dès le début, en deux coups de cuiller à pot. Je pense que la question avait déjà été réglée entre Pompidou, Huvelin, et sans doute De Gaulle lui-même. Le lundi 27, après quelques ultimes concessions de leur part, nous sommes sortis sur le perron du ministère du Travail pour présenter le texte destiné à devenir un accord. A la CGT, nous refusons de le signer séance tenante, faisant valoir que nous devions d’abord informer les travailleurs. Les négociations par branches devaient commencer le lendemain, et nous voulions aussi maintenir la pression. Au moment de sortir, Pompidou m’a dit : «Vous allez au moins appeler à la reprise du travail ?» Je lui ai répondu : «Ce n’est pas à nous d’en décider.» Et je suis parti chez Renault pour présenter ce que nous avions obtenu.
A Billancourt, l’accueil a été houleux…
On a raconté que je voulais faire cesser la grève et que je m’étais fait huer. Ce n’est pas du tout ce qui s’est passé. J’avais d’autant moins de raisons d’appeler à la reprise du travail que les camarades de Renault m’avaient informé avant qu’ils avaient déjà voté la poursuite de la grève à l’unanimité. J’avais pris des notes tout au long de la négociation, et je les ai lues. Ils applaudissaient quand je leur expliquais ce que l’on avait obtenu, et tout ce que l’on nous avait refusé, comme le paiement des jours de grève ou l’abrogation des ordonnances sur la sécurité sociale, ils le sifflaient. La confusion est venue de ce qu’un journaliste suisse, qui n’a pas assisté à l’ensemble du compte rendu, a entendu les sifflets et s’est empressé de téléphoner à son journal pour expliquer que la CGT s’était faite huer par les ouvriers de Renault. Et cela a ensuite été repris. Mais c’étaient les patrons et le gouvernement qui étaient hués, par nous.
Le 26 a lieu le meeting du stade Charléty. La CGT y est accusée de trahison…
Cela me laisse un souvenir amer. Je n’accepte pas que l’on ait pu nous accuser d’avoir trahi la classe ouvrière. Ce n’est pas juste. Je ne pense pas avoir mérité ça.
A Charléty, il a été reproché aux syndicats et aux partis de gauche de ne pas avoir osé prendre le pouvoir…
On m’a récemment posé cette question : «Avez-vous songé en mai 1968 à prendre le pouvoir ?» Quarante ans plus tard, je peux enfin répondre : oui, j’y ai songé. Mais il y avait un problème immédiat à résoudre : 8 millions de grévistes attendaient que l’on donne satisfaction à leurs revendications, les salaires, les 40 heures, sans oublier les questions de société. Admettons que nous ayons réussi, ils nous fallait ensuite des alliés pour prendre le pouvoir. La CGT seule ne pouvait y parvenir. Les autres syndicats n’étaient pas prêts à nous suivre sur ce terrain, les socialistes et la FGDS encore moins. Quant au Parti communiste, ce n’était pas forcément un bon allié puisqu’il nous considérait, paraît-il, comme une courroie de transmission. Admettons qu’on y soit arrivé. Il fallait ensuite que la police et l’armée n’intervienne pas pour nous empêcher de prendre le pouvoir. Restait enfin le plus important : comme nous sommes des démocrates, il fallait organiser des élections et les gagner. Pour quel résultat ? Benoît Frachon à l’Elysée et Georges Séguy à Matignon ? Et là, on s’est rendu compte que ce n’était tout simplement pas possible. Alors on s’est dit qu’il valait mieux aller négocier les accords de Grenelle…
(1) La CGT en revendique aujourd’hui 750 000.