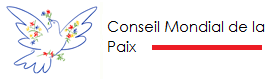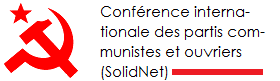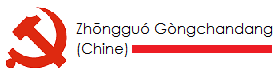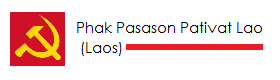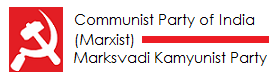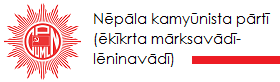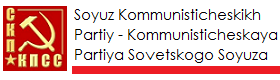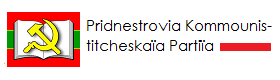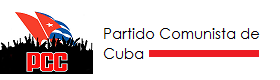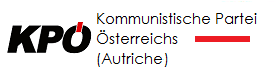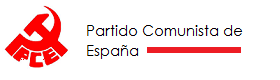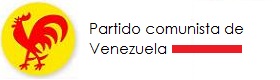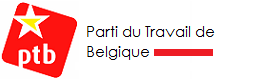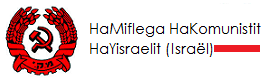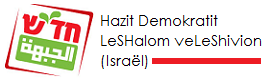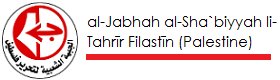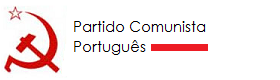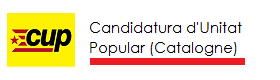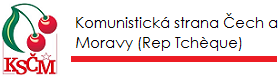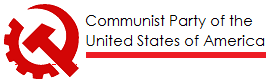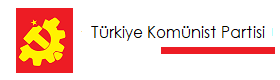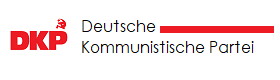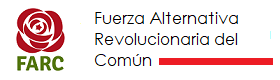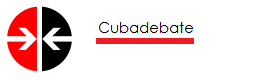ENTRETIEN. Le politologue Ronal Rodriguez décrypte les tensions entre le Venezuela et la Colombie, exacerbées par la présence de groupes paramilitaires. Par Claire Meynial
Sur les photos, ils donnent l'impression d'une nouvelle génération aux manettes. Iván Duque, 42 ans, petit et rond, et Juan Guaidó, 35 ans, grand et maigre, ont été portés au pouvoir par le rejet du chavisme. Duque a été élu président de la Colombie en août 2018 face à Gustavo Petro, ancien guérillero proche de Hugo Chávez. Le candidat malheureux n'a jamais réussi à rassurer son pays, pressuré par des vagues de réfugiés vénézuéliens affamés, sur le fait qu'il ne serait pas le Nicolás Maduro de Bogotá. Guaidó, président de l'Assemblée nationale, a assumé les fonctions de président de la République au Venezuela puisque la réélection largement considérée comme frauduleuse de Maduro le 20 mai 2018 équivalait, selon l'opposition, à une vacance du pouvoir. Selon la dernière enquête de Datanálisis, si une élection présidentielle avait lieu aujourd'hui, il l'emporterait avec 79 % des suffrages.
Les sorts des deux pays sont liés : pression migratoire, frontière poreuse que les groupes de guérilla traversent allègrement, transit par le Venezuela de la cocaïne colombienne… les deux jeunes présidents auraient tout à gagner à s'entendre. Pour Ronal Rodriguez, chercheur à l'Observatoire du Venezuela à l'université du Rosario, à Bogotá, en Colombie, c'est loin d'être gagné et le fiasco du 23 février, jour où l'aide humanitaire devait passer de la Colombie au Venezuela, a compliqué leurs rapports. L'analyste éclaire les ambitions concurrentes des pays de la région ainsi que les tensions au sein du Groupe de Lima, composé de quatorze États affectés par la crise migratoire consécutive à l'effondrement du Venezuela.
Le Point : Comment le 23 février a-t-il été vécu par le gouvernement colombien ?
Ronal Rodriguez : Cela a été compliqué. Il a adopté une position dure sur l'entrée de l'aide humanitaire, qui n'en était pas vraiment une. Tous les jours, de l'aide entre au Venezuela, par les chemins de contrebande à cause de la fermeture de la frontière. Mais celle du 23 février avait un caractère politique, l'objectif était de briser le gouvernement de Nicolás Maduro et sa logique d'accès aux biens, services et médicaments conditionné par le Carnet de la patrie, comme avec les caisses du CLAP (comité local d'approvisionnement et de production, aide alimentaire réservée aux sympathisants du parti au pouvoir au Venezuela, NDLR). Le gouvernement colombien a préparé un scénario, mais il ne maîtrisait pas certains éléments. L'opposition vénézuélienne avait dit qu'il y aurait bien plus de monde qui viendrait faire pression pour faire passer l'aide. Par ailleurs, la Colombie était au courant de la présence des colectivos, qui fonctionnent comme des groupes paramilitaires au service du chavisme, à cause des événements, notamment dans l'État frontalier de Táchira, de 2014 et 2017. Mais elle ne savait rien des groupes de la « Résistance » d'opposition, dont beaucoup étaient passés en Colombie parmi les réfugiés. Le week-end du 23 février, certains étaient dans la zone frontière, armés, ce qui a alerté les autorités colombiennes. Des rapports parlent de 400 personnes. Le gouvernement colombien n'a aucun discernement sur l'opposition vénézuélienne, qu'il voit comme un groupe homogène, et il s'est laissé orienter par les plus radicaux. Certains prennent leurs désirs de changement pour des réalités, ce qui a donné une vision déformée à la Colombie.
Donc, pour le président colombien Iván Duque, c'était un échec ?
En partie oui. Sur les réseaux sociaux, les sénateurs du Centre démocratique, le parti de Duque, proches de la communauté vénézuélienne d'opposition, comme Paula Holguín, pariaient sur le passage de l'aide. L'opposition vénézuélienne, et le gouvernement colombien l'a répété à l'envi, disait qu'on reproduirait l'épisode des Mères en blanc, qui ont forcé la réouverture de la frontière quand Nicolás Maduro l'avait fermée en 2015-2016. La popularité de Duque, dans les deux dernières enquêtes, a crû, grâce à sa position dure envers l'ELN (Armée de libération nationale, NDLR), mais aussi à sa gestion de la question vénézuélienne. Celle-ci pourrait se retourner contre lui. L'opposition a soutenu qu'il était plus préoccupé par les Vénézuéliens que par les problèmes des Colombiens. Sur les réseaux sociaux, l'ancien candidat à la présidentielle et aujourd'hui chef de l'opposition, Gustavo Petro, a utilisé ce genre d'arguments, qui d'ailleurs frisaient la xénophobie. En plus, des inondations tragiques ont eu lieu ces jours-là, le fleuve Chocó est sorti de son lit et la personne chargée de la gestion des risques était avec Duque à Cúcuta et ne s'est pas rendue sur les lieux assez vite. Cela a fait penser que le gouvernement ne s'occupait pas d'une situation qui affectait plus de 5 000 familles colombiennes, parce qu'il était occupé par ce qui se passait à la frontière vénézuélienne. Le lundi, le président a aussi beaucoup plus mis en avant la réunion du Groupe de Lima que le suivi de Chocó. Cela peut lui revenir en boomerang durant les mois à venir, d'élections locales. Les maires et les gouverneurs ont été sous pression et l'État ne leur a pas donné les moyens de réduire la pression migratoire. Dans beaucoup de régions où les Vénézuéliens se sont installés, le Centre démocratique et ses alliés pourraient en payer le prix électoral.
L'hypothèse d'un affrontement entre la Colombie et le Venezuela, auquel auraient pris part les États-Unis, était-elle crédible ?
Elle a toujours existé et c'est l'une des hypothèses que brandit le gouvernement de Maduro. Il l'a largement diffusée et a lancé toute une campagne, en faisant venir des universitaires européens de gauche, des dirigeants d'ONG de la gauche européenne et latino-américaine, pour répandre l'idée que l'entrée de l'aide visait à créer la confrontation. Mais cela n'a pas du tout été vécu ainsi à la frontière. Les gens savent que toute guerre des États-Unis doit être approuvée par le Congrès, en Colombie aussi. En revanche, on note dans la région frontalière la présence de mercenaires nord-américains, privés. Et de l'autre côté, celle de la pire figure du chavisme, Freddy Bernal, qui coordonne ou a des liens très étroits avec les colectivos. On a aussi vu Iris Varela, en charge du thème pénitentiaire au Venezuela, étroitement liée au milieu du crime des pranes (chefs de gangs en prison). Il y a aussi Diosdado Cabello, l'une des figures les plus discutables en termes de corruption au Venezuela. Plus qu'un affrontement entre États, la crainte, c'était que des acteurs non étatiques ne créent une situation incontrôlable.
Que signifie pour la Colombie l'influence croissante de l'ELN au Venezuela ?
C'est un thème critique. L'ELN n'est plus un groupe colombien, mais un groupe colombo-vénézuélien, avec des membres colombiens et vénézuéliens, présents dans les deux États. Au Venezuela, l'ELN se comporte différemment dans la zone frontalière et dans l'État de Bolívar, au sud, où il est plus lié au gouvernement. À la frontière, ceux qui passent par les chemins de contrebande disent qu'ils doivent payer un péage à l'ELN. Il y a même des zones où les gens préfèrent avoir affaire à eux plutôt qu'aux bandes criminelles. Parce que la guérilla est organisée, a des relations avec la société civile et a assumé certaines fonctions d'État pendant longtemps. La croissance exponentielle de l'ELN est inquiétante, de même que son accès à certains marchés du Venezuela. On a parlé d'une réunion entre l'ELN et des bandes criminelles locales (il y en aurait dix-sept, rien que dans le département de Norte de Santander). Il y aurait un plan, avec l'aval du gouvernement vénézuélien, pour se replier en Colombie en cas de départ de Maduro. Je pense aux colectivos qui savent que la population se vengera. J'ai déjà des rapports qui signalent l'apparition de membres de colectivos de Caracas à Bogotá, dans le quartier populaire de Ciudad Bolívar, ils créent des sortes de franchises. C'est une dimension nouvelle pour l'État colombien, à très hauts risques. C'est devenu un thème d'études. La présence de l'ELN est connue, de même que sa relation historique avec le Venezuela, notamment depuis les négociations secrètes sous Álvaro Uribe avec les Farc. Certaines ont eu lieu à Caracas, avec des agents du gouvernement vénézuélien comme Rodríguez Chacín, plus proche de l'ELN que des Farc. La Colombie ne voit plus l'ELN comme un problème interne, mais induit par la situation du Venezuela : sa maîtrise de territoires là-bas, les business auxquels elle a accès, le vide qu'elle a rempli dans la zone frontalière après la disparition des Farc et l'accroissement des groupes armés avec lesquels elle collabore ou contre lesquels elle se bat, sur fond de complicité du gouvernement.
Sa présence dans l'Arc minier vénézuélien inquiète-t-elle la Colombie ?
De toute évidence, son omniprésence là-bas, l'exploitation minière avec ses conséquences environnementales et la délinquance sont préoccupantes pour la Colombie parce que la frontière est complètement perméable au sud.
Quel est le rôle de la Colombie au sein du Groupe de Lima ?
Elle est moteur sur la crise vénézuélienne puisque c'est le pays qui en subit le plus de conséquences. Le Groupe de Lima n'a cependant pas réussi à maintenir la cohésion de l'an dernier. L'inclusion du point sur le Guyana dans la déclaration de cette année a généré des tensions internes, certains pays se sont rétractés et le Guyana n'est plus très présent. Par ailleurs, le Mexique qui était très actif cherche, avec López Obrador, à se donner un rôle de médiateur. Ce qui est en jeu, c'est aussi son influence dans les Caraïbes. Depuis la rupture de l'accord de San José en 2008 (de coopération énergétique entre le Venezuela et le Mexique, et onze pays des Caraïbes, NDLR) et avec l'absence des États-Unis, les Caraïbes se sont retrouvées un peu abandonnées. Hugo Chávez avait rempli ce vide avec Petrocaribe. Mais la chute de la production pétrolière a affaibli Petrocaribe. Cela représente une opportunité pour le Mexique qui veut récupérer une zone d'influence et le rôle prépondérant qu'elle avait en Amérique latine dans les années 1980 et 1990. C'est une stratégie très claire qui va à l'encontre des intérêts de la Colombie qui pourrait aussi avoir des prétentions dans les Caraïbes. Mais son leadership est affaibli, d'autant que le refus catégorique du Pérou et du Brésil a été évident lors de la dernière réunion du Groupe de Lima à Bogotá. La Colombie disait qu'il fallait mettre plus de pression sur le Venezuela, mais le Brésil, avec toute son influence, a plaidé la non-intervention des États-Unis, une position de l'armée brésilienne plus que de Bolsonaro. Cela a mené à une déclaration qui écartait catégoriquement toute logique militaire, dont la Colombie avait laissé la possibilité, de façon ambiguë. On a reproché à Duque et au ministre de ne pas s'y être opposés, mais ils la gardaient comme moyen de pression. La Colombie paiera tôt ou tard son alignement avec les États-Unis, parce que la dynamique anti-nord-américaine est très présente en Amérique latine. D'autant que les États-Unis peuvent faire volte-face à cause de la drogue. Ils sont très inquiets de l'augmentation des cultures en Colombie. Le pays n'aura alors plus le soutien des États-Unis, il n'aura pas non plus celui de la communauté latino-américaine et il se retrouvera orphelin.
Comment Duque et Guaidó s'entendent-ils ?
Officiellement, c'est une relation dynamique, de dialogue et d'échange d'informations. En coulisses, Duque a été agacé par le 23 février. Duque va probablement en payer le prix et il le transférera sur la relation avec le Venezuela. L'ambassadeur nommé par le gouvernement de transition en Colombie, Humberto Calderón Berti, peut aussi générer des tensions. Il fait partie de ceux qui dans les années 1980 et 1990 ont été les plus virulents dans le contentieux sur les zones marines et sous-marines entre la Colombie et le Venezuela. Pour certains diplomates, il porte un message sur ce différend.
Mais on parle d'une vague de droite sur le continent, d'un grand changement. La Colombie aurait beaucoup à gagner à s'entendre avec son voisin. Cela ne vous semble-t-il pas probable ?
Je ne sais pas si Guaidó et Duque s'entendraient. La relation entre les deux États est inexistante depuis presque vingt ans, toutes les commissions et structures ont disparu et les différences d'agenda sont nombreuses. Pour ce qui est du narcotrafic et des bandes armées à la frontière, il y aurait des points d'accord parce que Guaidó y trouverait son intérêt. Mais l'armée vénézuélienne est infiltrée par ces groupes et en pratique, ce sera difficile pour l'État vénézuélien de récupérer le monopole de la violence. Le thème de la frontière est l'un des plus tendus entre les deux pays, les militaires vénézuéliens passent à différents endroits. Depuis les accords de 1941, la frontière n'a cessé de bouger, à cause de divers phénomènes naturels et aucun accord n'a été trouvé entre les instituts de géographie des deux pays. Ce thème sera latent, le différend maritime aussi. Ils pourraient constituer un moyen de renforcer la cohésion des forces armées. Ces nouveaux leaders en Amérique latine qu'on dit de droite n'ont pas de communion idéologique. Quand l'ELN sera vue comme une force d'invasion du territoire vénézuélien, la Colombie, qui n'a pas su la contenir, sera désignée comme responsable. C'était la lecture du Venezuela sous Rafael Caldera (président de 1969 à 1974, et de 1994 à 1999). Ce sera aussi une façon d'obtenir une cohésion interne. Chaque pays a ses raisons d'État qui sont bien différentes. On verra alors si les présidents sont alliés.
Il n'y aurait donc pas de bénéfice particulier pour la Colombie à un changement de régime au Venezuela ?
On pourrait rénover les institutions bilatérales, les commissions qui se sont perdues avec le chavisme. Le thème de la migration a été un caillou dans la chaussure de la Colombie quand elle avait beaucoup de citoyens au Venezuela, elle a ignoré le problème. Le Venezuela fait la même chose. La grande majorité de ses citoyens ne rentreront pas. Il faudrait des accords pour les régulariser, mais je ne suis pas sûr que la Colombie soit disposée à le faire. Il y a tout un discours de soutien au Venezuela pour faire tomber Nicolás Maduro, mais on ne parle pas du thème migratoire, sur le fond. Le président pense que si Maduro part, tous les Vénézuéliens rentreront chez eux. Quand il se rendra compte que ce n'est pas le cas, son attitude changera peut-être envers la migration vénézuélienne.
Le Point