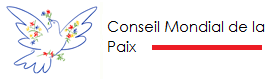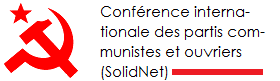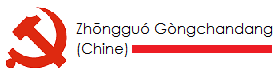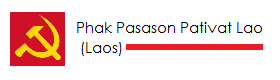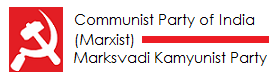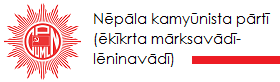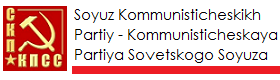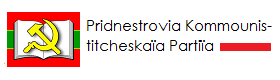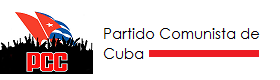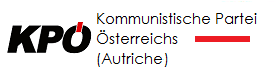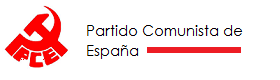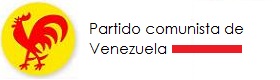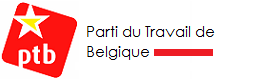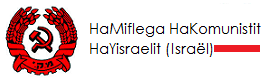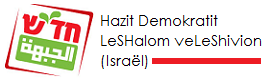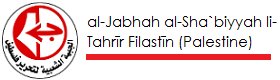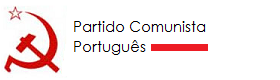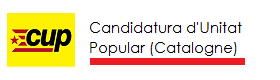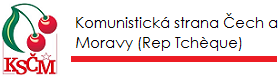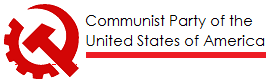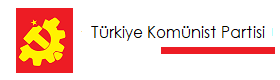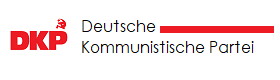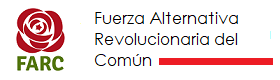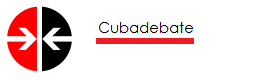En 1996, le gouvernement d’Alain Juppé transforme l’opérateur téléphonique public en société anonyme, en vue d’une ouverture du capital, qui est finalement effectuée en octobre 1997 par le gouvernement de la gauche parvenue entre-temps au pouvoir. « À l’époque, on nous disait aussi que les missions de service public étaient garanties, que l’État resterait à plus de 50 % du capital, se souvient le syndicaliste. Très rapidement, l’évolution législative a levé la barre des 50 % et des obligations de service public. » La participation de l’État, de 79 % après la première ouverture, chute à 62 % en 1998. En 2003, la droite vote une loi autorisant l’État à passer sous les 50 %. Ce saut, qui marque la « privatisation » au sens propre, est opéré en septembre 2004, huit ans après le changement de statut. Aujourd’hui, l’État ne détient plus que 27 % de France Télécom, qui fonctionne comme n’importe quelle entreprise privée. Pas étonnant qu’aucun bilan officiel n’ait été tiré de cette expérience, puisque la seule conclusion possible serait de renoncer à toute privatisation !
« Depuis dix ans, on est en plan social déguisé permanent », déplore Thierry Franchi, responsable CGT chez France Télécom. De 165 000 agents fonctionnaires en 1997, les effectifs de l’entreprise ont fondu à 95 000 aujourd’hui, dont 25 000 salariés de droit privé (presque uniquement des cadres). Pour supprimer massivement l’emploi sans trop de remous social, la direction a mis en place une préretraite maison, le « congé fin de carrière », ouverte aux fonctionnaires dès cinquante-cinq ans, avec des conditions financières quasi équivalentes au salaire. En dix ans, poussés par une forte inquiétude sur l’avenir, 40 000 agents ont utilisé de gré ou de force cette porte de sortie. Fin 2006, la direction a fermé cette préretraite pour des raisons financières, sans pour autant renoncer à la saignée des effectifs puisqu’elle a annoncé l’objectif de 22 000 suppressions de postes sur 2006-2008. Du coup, les méthodes d’incitation au départ se sont « musclées ». Les pressions sur les agents se multiplient pour les pousser à trouver un emploi dans la fonction publique ou à créer leur propre entreprise. À la fin de l’année, l’opérateur devrait ainsi afficher 90 000 salariés au compteur.
Lors de l’ouverture du capital, les chantres de la libéralisation promettaient un « gisement » d’emplois avec la création d’entreprises concurrentes. Mais aujourd’hui, l’ensemble du secteur des télécommunications en France emploie 140 000 salariés, soit 25 000 de moins que l’opérateur public à l’époque du monopole. En parallèle, France Télécom sous-traite l’équivalent de 25 000 emplois à des petites entreprises de service, d’informatique ou du bâtiment, mais avec des salaires et des conditions de travail au rabais.
Certes, comme promis à l’époque (et promis aujourd’hui aux postiers), les agents de France Télécom ont gardé leur « statut » de fonctionnaires, mais vidé de son contenu. « Le statut se résume maintenant à la sécurité de l’emploi », analyse Patrick Ackermann de SUD PTT. « Le système de mutations volontaires et de carrière à l’ancienneté a été supprimé, une gestion du personnel de type privé a été appliquée, avec des rémunérations au bonus et des évaluations individuelles. » L’étiquette « fonctionnaire » n’a pas empêché les agents de prendre de plein fouet la restructuration de l’entreprise. Les suppressions massives d’emplois, la sous-traitance et les délocalisations de services vers les pays à bas coûts ont permis une vague de fermetures de sites dans les petites villes et désormais dans les villes moyennes, au profit d’une centralisation des activités dans les capitales régionales. « France Télécom avait une présence territoriale du même ordre que La Poste aujourd’hui. Maintenant, tout a disparu », déplore Thierry Franchi, de la CGT. En parallèle, France Télécom a opéré un recentrage de son coeur de métier sur le « commercial » (boutiques et centres d’appels), aux dépens des services techniques, qui ont été largement sous-traités.
Ces deux processus ont provoqué des mobilités géographiques et professionnelles forcées, douloureuses pour le personnel. « En dix ans, 100 000 agents, soit presque tous, ont connu au moins un changement de métier », indique Patrick Ackermann de SUD, qui décrit une « crise profonde » dans le personnel. L’exemple le plus frappant est celui des techniciens qui, à la cinquantaine, se retrouvent en centres d’appel, avec des objectifs de vente qui heurtent leur culture de service public, et une hiérarchie qui ne songe qu’à se débarrasser d’eux (voir ci-contre). « Ils n’ont plus de métier, plus d’avenir dans l’entreprise, la souffrance est massive », dénonce le syndicaliste. « Il y a toujours plus de travail avec moins de personnel. On a compté six suicides depuis mai », rapporte Christian Mathorel, de la fédération CGT.
Pour les usagers, à qui on avait promis une baisse des tarifs grâce à la concurrence, la facture s’est au contraire alourdie, même si les comparaisons deviennent difficiles du fait de la « jungle tarifaire » qui s’est constituée, et qui donne du travail aux associations de consommateurs ! D’après SUD, les dépenses en télécommunications des ménages ont doublé en dix ans pour atteindre 3 % de leur budget. Et ce sont les plus modestes, les petits consommateurs, qui trinquent le plus puisque France Télécom augmente régulièrement le tarif de l’abonnement (16 euros aujourd’hui) en « échange » d’une baisse du prix des communications. Au moment de l’ouverture du capital, l’innovation qu’a constitué le lancement de la téléphonie portable a paru « justifier » une augmentation des tarifs. Mais après quelques années d’amortissement des équipements, les prix n’ont pas baissé, du fait d’une entente illicite entre les trois principaux opérateurs (Orange, SFR, Bouygues), condamnés par la justice en 2005 sur une plainte de l’UFC-Que choisir. L’oligopole privé a remplacé, le monopole public…
Chez France Télécom, de nombreux services autrefois gratuits sont devenus payants, comme le 12 depuis une cabine et les interventions de dépannage à domicile. En théorie celles-ci ne sont facturées que si la panne vient de l’installation domestique, mais les agents dénoncent les pressions de la hiérarchie pour facturer le plus souvent possible. Dans son numéro de septembre, le magazine Que choisir explique aussi que le prix d’ouverture d’une ligne, autrefois fixé à 40 euros, peut aujourd’hui grimper à 2 000 euros, selon le lieu de résidence et la difficulté des travaux. Pour toutes ces interventions, les clients attendent jusqu’à quinze jours, du fait du sous-effectif.
La privatisation a également remis en cause l’égalité sur tout le territoire. Seules les grandes villes rentables pour les opérateurs bénéficient du haut débit et bientôt de la fibre optique, tandis que les campagnes gardent un réseau cuivre en dégradation, faute d’investissements de France Télécom. « Avec les objectifs de rentabilité, c’est l’abandon de l’aménagement du territoire et de l’accès au téléphone pour tous. L’idée de France Télécom, c’est de faire financer le réseau de fibre optique par les collectivités », dénonce Christian Mathorel de la CGT.
Comme pour La Poste aujourd’hui, les dirigeants de France Télécom en 1997 ont fait miroiter aux agents l’espoir de tirer profit de la privatisation en devenant actionnaires. « Pour la direction, c’était un formidable outil de management », rapporte Christian Mathorel, de la CGT, qui compare le salarié actionnaire au « crocodile dans la maroquinerie », poussé à « accepter les changements, voire à être licencié, pour que l’action monte ». Malgré les mises en garde de SUD et de la CGT, 80 % à 90 % des agents ont acheté des actions au prix très incitatif offert par la direction. « Pendant un moment ils ont été virtuellement riches, mais ensuite ils sont tombés de haut », raconte le syndicaliste. Introduite en Bourse au prix de 27 euros, l’action grimpe à 219 euros en 2000. Mais cette année-là, l’éclatement de la bulle Internet vient frapper une France Télécom en pleine euphorie d’acquisitions, avec notamment l’achat d’Orange pour 43 milliards d’euros. En 2002, l’action chute à 10 euros, tandis que la dette de l’entreprise atteint 70 milliards d’euros et justifie les tours de vis imposés aux salariés en termes d’emplois et de conditions de travail. Aujourd’hui l’action se vend 19 euros. « Des collègues ont gagné de l’argent dans cette histoire, mais ils ne s’en vantent pas, raconte Patrick Ackermann, de SUD. Certains avaient l’illusion que l’actionnariat salarié pouvait peser au conseil d’administration, mais ils voient bien que c’est une goutte d’eau. »