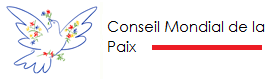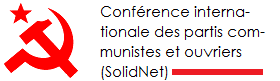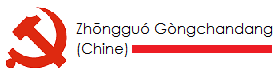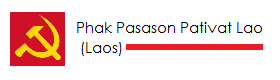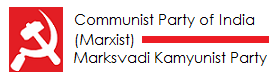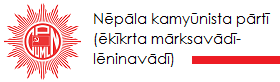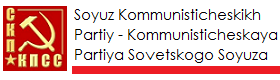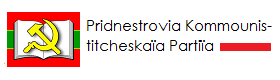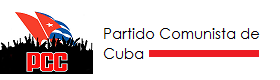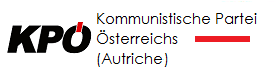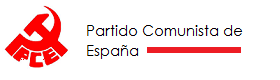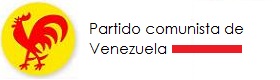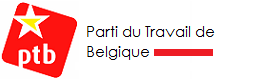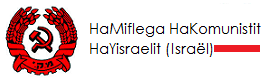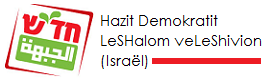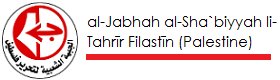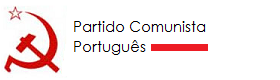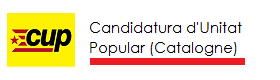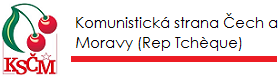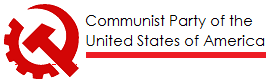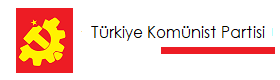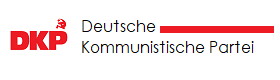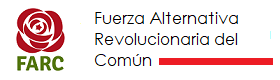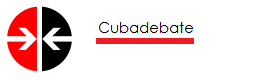En fait l’allongement des périodes d’essai présente deux avantages au yeux des patrons : se débarrasser quand ils le veulent des éléments jugés indésirables et pendant toutes ces périodes faire suer le burnous au maximum aux personnes embauchées à l’instar des méthodes de cette grande surface qui prenait 20 jeunes en contrats de qualification de deux ans en même temps et en annonçant qu’à l’arrivée il y en aurait 5 recrutés en CDI : des mères affolées devant l’état d’épuisement de leurs fils mis ainsi en concurrence appelaient l’inspection du travail pour demander ce qu’il était possible de faire.
Il faut savoir cependant que les périodes d’essai sont fixées par les conventions collectives de branches, l’accord interprofessionnel et la loi ne peuvent les abroger. Il faudra que dans chaque branche les patrons obtiennent les signatures syndicales.
La séparation à l’amiable
Il s’agit d’organiser une vaste fraude aux Assedic incompatible avec « la France qui se lève tôt ».
En fait cette modalité de rupture existe depuis toujours. La nouveauté serait qu’elle ouvrirait droit aux allocations chômage alors qu’actuellement il faut « être involontairement privé d’emploi » pour toucher les allocations.
Aujourd’hui « la séparation à l’amiable » se pratique autrement. Les départs, le plus souvent après 57 ans, sont arrangés entre employeurs et salariés : une lettre de licenciement avec un motif imaginaire accepté par le salarié. L’entreprise réduit ainsi, ou renouvelle, ses effectifs à peu de frais, le salarié de son côté est satisfait de partir en retraite anticipée payée pendant trois ans par l’Assedic. Ces pratiques sont légion en particulier dans les plus grandes entreprises. Actuellement 450 000 personnes sont ainsi dispensées de recherche d’emploi, non comptées dans les chiffres du chômage.
L’accord conclu légaliserait donc ces pratiques frauduleuses. Mais en plus il conduira à plus de licenciements : l’employeur qui veut se débarrasser d’un salarié pourra pousser le salarié vers la porte en lui menant la vie dure tout en lui faisant miroiter comme issue les allocations chômage au lieu d’une hypothétique procédure prud’hommale. En quelque sorte les allocations Assedic se substitueraient aux dommages payés par l’employeur sur décision du juge.
Il s’agirait, dit le Medef, de protéger les chefs d’entreprise contre l’insécurité juridique que représente les procédures devant les conseils des prud’hommes. D’où aussi l’exigence d’un plafonnement des indemnités accordées par le juge en cas de licenciement abusif. Etonnant de la part de gens qui prétendent que la caractéristique première de ces surhommes que sont les chefs d’entreprise c’est justement le goût du risque qui justifie leurs hautes rémunérations !
Mais quelle est donc dans la réalité l’ampleur du risque pris par le patron quand il licencie ? Le recoupement de diverses sources donnent ceci : bon an, mal an 800 000 licenciements par an, 140 000 procédures engagées en justice par les victimes dont 40 000 aboutissent à des condamnations en dommages et intérêts d’un montant moyen de trois mois de salaire, c’est-à-dire que chacun des 800 000 licenciements coûte en moyenne environ 250 € au patronat pris dans son ensemble. On voit l’urgence à protéger les chefs d’entreprise contre une telle menace !
Il y a bien sûr des cas où la condamnation est plus lourde, 6 mois de salaire, deux ans, quatre ans dans des cas extrêmes. Il reste que ces condamnations visent les cas ou l’abus patronal est manifeste et où le préjudice subi par le salarié est parfois considérable. En réalité le préjudice subi par un salarié de plus de 50 ans ayant fait toute sa carrière dans la même entreprise n’est jamais complètement réparé ; nombreux sont ceux qui, dans cette situation, ne retrouveront plus jamais de travail. Qui donc prend les risques et doit être protégé contre l’insécurité juridique ?
Est-ce que Sarkosy osera, d’une part légaliser les fraudes massives aux Assedic permises par l’accord et, d’autre part, favoriser la tâche de ces voyous qui mettent le couteau sous la gorge d’un travailleur en lui disant : « tu signes à l’amiable avec trois mois d’indemnités ou je continue à te mener la vie dure, tu seras tout de même lourdé et je te garantis qu’alors tu ne retrouveras plus jamais de travail dans la région ». Ces pratiques existent déjà mais en les légalisant on risque de les multiplier et on rend quasi impossible les contestations par les victimes. L’homologation par les directions départementales du travail pose enfin deux problèmes : d’abord, vu le nombre de ruptures, ces directions ne pourront pas suivre, ensuite il semble que le gouvernement a oublié de signaler aux négociateurs qu’il a prévu, dès 2008, la disparition des directions départementales du travail ?
La question se pose : peut-on en France interdire à un citoyen de demander réparation en justice quoi qu’il ait signé ? les tribunaux ne peuvent être privé du droit d’apprécier les conditions dans lesquelles le consentement à été obtenu, les motifs réels de la rupture, ainsi que le montant de la réparation du préjudice.
Un nouveau motif de CDD : le contrat de mission ou le contrat à objet défini.
Pas si nouveau que cela. Petit rappel historique : dans le silence du code du travail c’est le code civil qui réglemente le contrat de travail, or ce Code napoléon prévoit qu’on peut engager ses services pour une entreprise (un objet) déterminée. Cette possibilité a toujours donné lieu à de nombreux abus et à une très grande précarité tempérée cependant dans ses conséquences dans les périodes de faible chômage comme celle des années 60. En 1982 une ordonnance vient limiter une première fois le CDD de mission en obligeant à fixer une date de fin de contrat. Puis une loi du 12 juillet 1990 interdit totalement ce type de contrat. Mais ce qu’il ne faut pas oublier, c’est que cette loi reprenait le contenu de l’accord interprofessionnel du 24 mars 1990 signé par le CNPF et les syndicats, CGT comprise. Bien que rarement, il arrivait encore à l’époque que le patronat signe des accords de progrès social.
Aujourd’hui le Medef récuse ce que ses prédécesseurs ont admis il n’y a pas si longtemps. On peut se demander dès lors ce que valent les signatures patronales.
Les délégations syndicales l’ont souligné, le CDD de mission serait un mauvais coup contre les salariés car il cumulerait les défauts du CDD c’est-à-dire l’éviction de l’entreprise sans autre motif que la fin de la mission et les défauts du CDI à savoir la possibilité du licenciement à tout moment. Exit la durée minimum garantie du CDD mais exit aussi la nécessité d’un motif réel et sérieux pour licencier du CDI.
Les constructeurs automobiles, par exemple, recourent fréquemment aux CDD (sous la forme intérim) lors du lancement d’un nouveau modèle et pendant toute la période de montée en charge et même au-delà. C’est le plus souvent illégal parce qu’il n’y a pas « accroissement temporaire de l’activité », il y a toujours en effet des nouveaux modèles. Les tribunaux, quand ils sont saisis, requalifient les contrats ainsi conclus en CDI. Avec le contrat de mission à objet précis on pourrait, en toute légalité, écrire à un salarié qu’il est recruté pour la période de lancement de tel nouveau modèle ou bien pour la période de montée en charge de tel marché à l’export, c’est le chef d’entreprise qui décréterait à tout moment que la période de lancement est terminée.
Avec 900 000 CDD et 650 000 intérimaires en permanence (donc deux fois plus de personnes concernées puisque ces précaires ne travaillent en moyenne que 6 mois par an) l’emploi précaire est déjà à un niveau très élevé, ça ne suffit pas aux actionnaires des grands groupes qui veulent toujours plus, conformément au credo de Laurence Parisot selon laquelle « la vie, l’amour, la santé sont précaires, pourquoi le travail échapperait-il à cette règle ? »
L’accord limite ce nouveau CDD aux ingénieurs et cadres. Rien n’empêchera demain de l’étendre à tous comme cela s’est fait avec le forfait jour réservé aux cadres par Aubry et étendu récemment à tous les salariés.
De plus l’accord prévoit la légalisation du « portage salarial », cette forme extrême de l’intérim où un salarié (le porté) se cherche des missions chez des clients, un intermédiaire (l’entreprise de portage) établissant des factures au client et les transformant en salaires après avoir déduit sa commission. Du trafic de main d’œuvre actuellement illégal.
On fera un sort rapide à la promesse que tous ces suppléments de souplesse favoriseront l’embauche et la lutte contre le chômage. Cette soupe a été servie cent fois depuis la légalisation de l’intérim en 1972 jusqu’à la dernière loi sur le rachat des RTT en passant par l’abrogation du volet anti-licenciement de la loi de modernisation sociale. On connaît les résultats.
Quant aux concessions qu’auraient arrachées les syndicats c’est la misère : Indemnité de licenciement portée à 1/5ème de mois de salaire, c’est déjà ce que prévoit la plupart des conventions collectives et c’est très faible (deux mois pour dix ans d’ancienneté, en Espagne c’est cinq fois plus depuis longtemps). Portabilité de certains droits comme les 20 petites heures de DIF annuels. Stages des jeunes pris en compte dans la période d’essai, encore heureux puisque ces stages sont des essais, de surcroît non ou mal payés.
Dans ces conditions l’accord est favorable au patronat à 99 %. Mystère ?